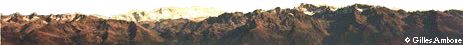On pense à partir de ce qu'on écrit et pas le contraire... Louis Aragon
Depuis le début des années 80, les interfaces des ordinateurs évoluent en même temps que le nombre d'utilisateurs d'outils informatiques augmente. Elles se veulent de plus en plus conviviales, de plus en plus agréables et faciles à utiliser. L'apparition de nouveaux médias et de nouveaux moyens de communication pousse encore cette évolution
L'interface idéale permettrait de recréer au mieux les conditions d'un dialogue Homme-Homme dans un dialogue Homme-Machine. Ceci limitant au maximum tous les efforts d'apprentissage nécessaires à l'approche d'une machine, et ferait certainement disparaître toute appréhension à son contact. Mais il faut remarquer que l'imitation du dialogue Homme-Homme par le dialogue Homme-Machine ne peut constituer un projet ni à long terme ni dans l'absolu. A très long terme, on peut supposer que la communication Homme-Machine pourra être parfaitement maîtrisée : reconnaissance de la parole continue, des formes, des gestes, compréhension des signaux correspondant à chacun des ces modes d'expression et de leur complémentarité, etc... Mais, dans l'absolu la communication suppose que chacun des acteurs possède un modèle des autres. Or le modèle de la machine que l'utilisateur se construit n'est pas une copie du modèle d'un être humain. De là un biais insurmontable entre communications Homme-Homme et Homme-Machine.
Tout au long de ce travail, nous avons essayer de rendre plus rapide et plus facile l'utilisation des ordinateurs dans des phases de création de documents graphiques. L'apparition des ordinateurs à stylo a bien entendu facilité notre tâche, mais encore fallait-il concevoir les logiciels, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau de l'interface.
Ce que nous proposons dans ce document est l'ensemble des solutions que nous avons apporté en nous intéressant à de multiples domaines. Chacun des choix, chacune de nos solutions a été dicté par le type d'applications choisies et le caractère interactif de celles-ci. Ainsi nous ne prétendons pas fournir des réponses définitives aux problèmes posés dans chacun des domaines abordés, mais nous pensons avoir proposé de bonnes solutions, et de plus réutilisables, dans chacune des matières abordées. Il faut comprendre que le montage d'une ou plusieurs plate-formes multimodales, comme celles que nous avons réalisées, demande de l'expertise dans beaucoup de domaines de l'informatique. Ainsi nous pouvons citer la connectique, les réseaux, l'intelligence artificielle, la reconnaissance des formes, l'ergonomie, l'architecture logicielle et matérielle, les systèmes, etc... Souvent, l'étude d'un seul sujet dans l'un de ces domaines fait l'objet d'une thèse. Notre ambition était de faire une thèse en intégrant efficacement toutes les parties intéressantes de ces domaines pour des applications graphiques dans lesquelles l'utilisateur à la possibilité d'utiliser différentes modalités pour parvenir à son objectif.
Pour atteindre notre dessein, nous avons abordé notre sujet sous divers angles, travaillant le plus souvent en parallèle, ce qu'une présentation séquentielle peut difficilement faire apparaître. Pour présenter notre travail, nous avons donc découpé notre document en 5 parties principales qui représentent chacun des sujets traités.
Dans un premier temps, dans le Chapitre II, nous étudierons la conception des interfaces, tant au niveau du matériel choisi qu'au niveau de la création proprement dite, utilisant ainsi quelques notions d'ergonomie.
Le troisième Chapitre est consacré aux architectures logicielles. Celles qui sont couramment utilisées pour créer des applications interactives ou distribuées, et celles que nous avons développé spécifiquement pour nos démonstrateurs.
Dans le Chapitre IV, ce sont des algorithmes de reconnaissance des formes, dédiés totalement à nos applications que nous présentons. Ils sont particulièrement efficaces dans un contexte interactif de dialogue homme-machine, comme nous le verrons.
La présentation détaillée des prototypes et autres démonstrateurs est donnée au Chapitre V de ce document. Nous montrerons pour chacun d'entre eux les caractéristiques techniques et les concepts, décrits dans les chapitres précédents, que nous avons utilisés.
Enfin, avant de conclure notre travail, nous avons proposé et effectué des évaluations. Evaluation de l'interaction et évaluation des algorithmes de reconnaissance. Nous en découvrirons les résultats au Chapitre VI.
En plus d'une bibliographie générale et classée par thèmes, le lecteur trouvera à la fin de ce document des annexes. Elles comprennent, entre autres, des descriptions de matériels ou de logiciels que nous avons rencontré tout au long de notre étude et un glossaire détaillé des noms barbares ou des abréviations que nous avons été amené à utiliser.

|

|